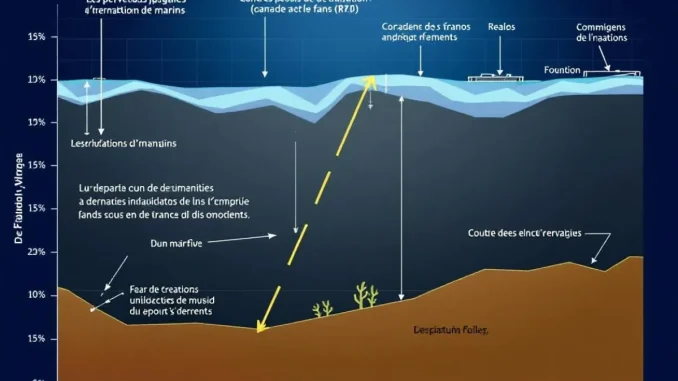
L’exploitation des fonds marins représente une frontière juridique complexe où se croisent droit international, préoccupations environnementales et intérêts économiques. Alors que la technologie permet désormais d’accéder à des ressources minérales situées à plusieurs milliers de mètres sous la surface des océans, le cadre juridique qui encadre ces activités évolue rapidement. Entre le principe de patrimoine commun de l’humanité et les revendications nationales, entre protection des écosystèmes fragiles et course aux métaux rares, le droit de l’exploitation des fonds marins constitue un domaine en constante mutation. Ce texte analyse les fondements juridiques, les enjeux contemporains et les perspectives d’avenir de cette branche du droit maritime aux implications mondiales.
Le cadre juridique international de l’exploitation des fonds marins
L’encadrement juridique de l’exploitation des fonds marins trouve son fondement principal dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) adoptée à Montego Bay en 1982. Ce texte fondateur établit que les fonds marins situés au-delà des juridictions nationales constituent le « patrimoine commun de l’humanité« . Cette qualification juridique révolutionnaire implique que ces espaces ne peuvent faire l’objet d’une appropriation par les États et que leur exploitation doit bénéficier à l’ensemble de l’humanité.
La CNUDM a créé l’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM), organisation intergouvernementale chargée d’organiser et de contrôler les activités menées dans la Zone – terme désignant les fonds marins au-delà des juridictions nationales. L’AIFM, dont le siège est à Kingston en Jamaïque, élabore un Code minier pour encadrer l’exploration et l’exploitation des ressources minérales des grands fonds.
En complément de la CNUDM, d’autres instruments juridiques internationaux influencent le régime d’exploitation des fonds marins :
- L’Accord de 1994 relatif à l’application de la Partie XI de la CNUDM, qui a modifié certaines dispositions jugées trop contraignantes par les pays industrialisés
- La Convention sur la diversité biologique de 1992, qui s’applique aux ressources génétiques marines
- Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages
Les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies contribuent à l’évolution normative, notamment celles concernant la pêche de fond et la protection des écosystèmes marins vulnérables. En 2015, l’Assemblée générale a lancé les négociations d’un nouvel accord juridiquement contraignant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones au-delà des juridictions nationales (processus BBNJ).
La délimitation des zones d’exploitation constitue un aspect fondamental du régime juridique. La CNUDM distingue plusieurs espaces maritimes avec des régimes juridiques différents : les eaux territoriales (12 milles marins), la zone économique exclusive (200 milles marins), le plateau continental (jusqu’à 350 milles marins dans certaines conditions) et la Zone internationale des fonds marins. Cette délimitation détermine si l’exploitation relève de la juridiction nationale ou du régime international géré par l’AIFM.
Les ressources convoitées et les régimes d’exploitation
Les fonds marins recèlent une diversité de ressources qui font l’objet d’intérêts économiques croissants. Parmi les plus convoitées figurent les nodules polymétalliques, concrétions rocheuses riches en manganèse, nickel, cuivre et cobalt qui jonchent les plaines abyssales à plus de 4000 mètres de profondeur. La zone Clarion-Clipperton dans le Pacifique concentre d’importants gisements faisant l’objet de contrats d’exploration.
Les encroûtements cobaltifères se forment sur les flancs des monts sous-marins et contiennent des concentrations élevées de cobalt, un métal stratégique pour les batteries et l’industrie aérospatiale. Les sulfures hydrothermaux, quant à eux, se forment autour des sources hydrothermales et sont riches en cuivre, zinc, or et argent.
Au-delà des ressources minérales, les fonds marins abritent des ressources génétiques marines d’une valeur considérable pour les industries pharmaceutique et biotechnologique. Ces organismes extrêmophiles présentent des propriétés uniques adaptées aux conditions extrêmes des grands fonds.
Régimes d’attribution des permis d’exploration et d’exploitation
Dans la Zone internationale, l’AIFM a développé trois règlements concernant l’exploration des nodules polymétalliques (2000), des sulfures hydrothermaux (2010) et des encroûtements cobaltifères (2012). Le processus d’attribution des contrats d’exploration suit plusieurs étapes :
- Dépôt d’une demande par un État sponsor ou une entité patronnée par un État
- Examen technique par la Commission juridique et technique de l’AIFM
- Approbation par le Conseil de l’AIFM
- Signature d’un contrat d’une durée de 15 ans
À ce jour, l’AIFM a accordé une trentaine de contrats d’exploration à des entités publiques et privées. Le régime d’exploitation, quant à lui, reste en cours d’élaboration, avec des discussions intenses sur le partage des bénéfices, les redevances et les normes environnementales.
Dans les zones sous juridiction nationale, les États côtiers établissent leurs propres régimes d’attribution de permis conformément à leur législation. La France, par exemple, a adopté en 2016 une ordonnance relative à l’exploration et à l’exploitation des ressources minérales des grands fonds marins, tandis que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a délivré le premier permis d’exploitation commerciale de sulfures hydrothermaux à la société Nautilus Minerals (projet Solwara 1, aujourd’hui abandonné).
Des tensions existent entre les approches nationales et le régime international, notamment concernant l’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins, qui permet aux États d’exercer des droits souverains sur les ressources du sol et du sous-sol marin dans ces zones étendues.
Les défis environnementaux et le principe de précaution
L’exploitation des fonds marins soulève d’importantes préoccupations environnementales en raison de la fragilité et de la méconnaissance des écosystèmes abyssaux. Les impacts potentiels incluent la destruction physique des habitats lors des opérations d’extraction, la création de panaches sédimentaires qui peuvent étouffer la faune sur de vastes zones, la pollution lumineuse et sonore dans des milieux habituellement plongés dans l’obscurité, et la libération potentielle de métaux lourds dans la colonne d’eau.
Face à ces risques, le principe de précaution s’impose comme une norme juridique fondamentale. Inscrit dans la Déclaration de Rio de 1992, ce principe implique que l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures de protection de l’environnement. La CNUDM impose aux États et à l’AIFM de prendre les mesures nécessaires pour protéger efficacement le milieu marin contre les effets nocifs des activités minières.
Concrètement, l’application du principe de précaution se traduit par plusieurs obligations juridiques :
- La réalisation d’études d’impact environnemental préalables à toute activité d’exploration ou d’exploitation
- La mise en place de zones de référence pour la préservation de la biodiversité
- L’établissement de plans de gestion environnementale régionaux
- Le suivi continu des impacts environnementaux pendant et après les opérations
Les aires marines protégées et zones d’intérêt écologique particulier
Pour préserver la biodiversité des grands fonds, l’AIFM a développé le concept de Zones d’Intérêt Écologique Particulier (ZIEP) où toute activité minière est interdite. Dans la zone Clarion-Clipperton, neuf ZIEP ont été désignées dans le cadre du Plan de gestion environnementale régional. Ces zones sanctuarisées visent à maintenir la connectivité écologique et à préserver des échantillons représentatifs des habitats abyssaux.
En parallèle, les Aires Marines Protégées (AMP) créées par les États dans leurs zones maritimes ou par des organisations régionales contribuent à la protection des écosystèmes des fonds marins. L’objectif international de protéger 30% des océans d’ici 2030 (objectif 30×30) influence l’évolution des régimes de protection.
La jurisprudence internationale renforce progressivement les obligations environnementales. Dans son avis consultatif de 2011, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM) a précisé les obligations des États sponsors concernant l’application du principe de précaution, l’utilisation des meilleures techniques disponibles et la conduite d’études d’impact environnemental.
Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle croissant dans la gouvernance environnementale des fonds marins, exerçant une pression sur l’AIFM et les États pour renforcer les mesures de protection. Des initiatives comme la Deep Sea Conservation Coalition ou l’appel à un moratoire sur l’exploitation minière des grands fonds illustrent cette mobilisation de la société civile.
Les conflits d’intérêts et la géopolitique des fonds marins
L’exploitation des fonds marins s’inscrit dans un contexte géopolitique complexe où s’affrontent intérêts économiques, considérations stratégiques et enjeux de souveraineté. La course aux métaux critiques – indispensables aux technologies vertes et numériques – intensifie ces tensions. Le contrôle des gisements sous-marins de terres rares, de cobalt ou de lithium représente un enjeu stratégique majeur dans un contexte de transition énergétique et de digitalisation.
Les grandes puissances maritimes comme la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon et plusieurs pays européens ont développé des programmes ambitieux d’exploration des fonds marins. La Chine, en particulier, a obtenu plusieurs contrats d’exploration auprès de l’AIFM et investit massivement dans les technologies d’exploitation sous-marine, dans le cadre de sa stratégie de sécurisation des approvisionnements en matières premières stratégiques.
Les revendications territoriales sur les plateaux continentaux étendus constituent une source potentielle de conflits. La Commission des limites du plateau continental des Nations Unies examine les demandes d’extension soumises par les États côtiers, mais ses recommandations ne règlent pas les différends territoriaux sous-jacents. En Arctique, par exemple, les revendications concurrentes du Canada, de la Russie et du Danemark (pour le Groenland) sur la dorsale de Lomonossov illustrent ces tensions.
Les mécanismes de résolution des conflits
La CNUDM prévoit plusieurs mécanismes de règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de ses dispositions :
- Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), basé à Hambourg
- La Cour internationale de Justice (CIJ)
- L’arbitrage selon l’annexe VII de la Convention
- L’arbitrage spécial selon l’annexe VIII pour certaines catégories de différends
Pour les différends spécifiques aux activités menées dans la Zone, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du TIDM dispose d’une compétence obligatoire. Cette juridiction spécialisée peut être saisie par les États parties, l’AIFM ou les contractants.
Les tensions entre pays développés et pays en développement persistent concernant le partage des bénéfices issus de l’exploitation des ressources des fonds marins. Le concept de patrimoine commun de l’humanité implique une répartition équitable des avantages, mais les modalités pratiques de cette répartition font l’objet de négociations difficiles au sein de l’AIFM.
Des initiatives de diplomatie préventive émergent pour désamorcer les conflits potentiels. Les codes de conduite régionaux, les déclarations conjointes et les mécanismes de consultation contribuent à instaurer un climat de confiance entre les acteurs. La transparence des activités d’exploration et d’exploitation constitue un enjeu majeur pour prévenir les tensions.
L’horizon juridique de l’exploitation durable des fonds marins
L’avenir du droit de l’exploitation des fonds marins se dessine à travers plusieurs évolutions normatives en cours. Le Code minier en préparation à l’AIFM représente l’une des pièces maîtresses de ce futur cadre juridique. Les négociations portent notamment sur les normes environnementales, le système de redevances, les mécanismes de compensation en cas de dommage et les procédures d’inspection et de contrôle.
L’adoption en 2022 du Traité sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales (BBNJ) constitue une avancée significative. Ce nouvel instrument juridique international vise à combler les lacunes de la CNUDM concernant la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales. Il prévoit la création d’aires marines protégées en haute mer, l’encadrement des études d’impact environnemental, le partage des avantages issus des ressources génétiques marines et le renforcement des capacités des pays en développement.
L’émergence d’un droit minier sous-marin responsable s’appuie sur plusieurs principes en développement :
- L’approche écosystémique, qui prend en compte l’ensemble des interactions au sein des écosystèmes marins
- La planification spatiale marine, qui organise la répartition des activités dans l’espace maritime
- Le principe de responsabilité environnementale, qui implique la réparation des dommages causés à l’environnement
- Le consentement préalable, libre et éclairé des communautés potentiellement affectées
Vers une économie circulaire des ressources marines
Face aux préoccupations environnementales, des approches alternatives à l’exploitation intensive des fonds marins se développent. Le concept d’économie circulaire appliqué aux ressources marines encourage le recyclage des métaux déjà extraits, la réutilisation des matériaux et l’écoconception des produits pour réduire la demande en matières premières.
Des moratoires temporaires sur l’exploitation commerciale des fonds marins sont proposés par certains États, organisations internationales et ONG pour permettre l’approfondissement des connaissances scientifiques et le développement de technologies moins invasives. En 2021, le Parlement européen a appelé à un tel moratoire, suivi par plusieurs autres pays comme la France et le Chili.
La participation de toutes les parties prenantes à la gouvernance des fonds marins constitue un défi majeur. Le renforcement de la transparence des processus décisionnels de l’AIFM, l’inclusion des communautés côtières et des peuples autochtones dans les consultations, et la prise en compte des avis scientifiques indépendants représentent des évolutions nécessaires pour une gouvernance plus inclusive.
Le développement de technologies d’exploitation à faible impact constitue un axe prometteur. Des recherches sont menées pour concevoir des équipements minimisant la perturbation des fonds marins, réduisant les panaches sédimentaires et limitant le bruit sous-marin. Ces innovations pourraient permettre une exploitation plus respectueuse des écosystèmes.
À terme, l’équilibre entre exploitation économique et préservation environnementale reposera sur un cadre juridique robuste, adaptatif et fondé sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. La coopération internationale, le transfert de technologies vers les pays en développement et le partage équitable des bénéfices constitueront les piliers d’un régime d’exploitation véritablement durable des fonds marins.
Le futur de la gouvernance océanique mondiale
L’évolution du droit de l’exploitation des fonds marins s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation de la gouvernance océanique mondiale. Face aux défis interconnectés du changement climatique, de la perte de biodiversité et de l’exploitation des ressources, une approche intégrée devient indispensable. Cette vision holistique se traduit par le développement de cadres juridiques prenant en compte l’ensemble des activités humaines en mer et leurs interactions.
Les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, particulièrement l’ODD 14 consacré à la vie aquatique, orientent cette évolution. L’objectif de conservation d’au moins 30% des océans d’ici 2030 (30×30), adopté dans le cadre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, influence directement les politiques d’exploitation des fonds marins.
Le renforcement des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et leur coordination avec l’AIFM constituent des enjeux majeurs pour assurer la cohérence des mesures de protection et d’exploitation. Des mécanismes de coopération entre ces différentes institutions se mettent progressivement en place pour éviter les approches sectorielles cloisonnées.
Le rôle croissant du droit souple et des acteurs privés
Parallèlement au droit conventionnel, le droit souple (soft law) joue un rôle croissant dans l’encadrement des activités d’exploitation des fonds marins. Les codes de conduite volontaires, les lignes directrices, les normes ISO et les certifications environnementales complètent le cadre juridique contraignant.
Le secteur privé développe des initiatives d’autorégulation. Des entreprises minières marines se sont regroupées au sein du Deep Sea Mining Coalition et ont adopté des engagements volontaires concernant les pratiques responsables. Les investisseurs institutionnels intègrent progressivement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions de financement des projets d’exploitation sous-marine.
Les mécanismes financiers innovants comme les obligations bleues (blue bonds) ou les paiements pour services écosystémiques marins offrent des alternatives économiques à l’exploitation intensive des ressources minérales des fonds marins. Ces instruments valorisent la conservation des écosystèmes marins et les services qu’ils rendent à l’humanité.
- Les partenariats public-privé pour la recherche océanographique
- Les fonds fiduciaires pour la conservation marine
- Les mécanismes de compensation biodiversité
- Les marchés de crédits carbone bleu
La numérisation de la gouvernance des océans transforme la surveillance et le contrôle des activités d’exploitation. Les technologies de télédétection, l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle et la blockchain permettent un suivi en temps réel des opérations minières, une traçabilité accrue des ressources extraites et une détection précoce des impacts environnementaux.
À l’horizon 2050, la gouvernance des fonds marins pourrait s’articuler autour d’un système adaptatif fondé sur l’apprentissage continu et les retours d’expérience. Les approches expérimentales, avec des sites pilotes soumis à un suivi scientifique rigoureux, permettraient d’affiner progressivement les pratiques et les réglementations. Cette gouvernance adaptive reconnaîtrait la nature dynamique des écosystèmes marins et les incertitudes inhérentes à leur exploitation.
Le défi majeur consistera à concilier les principes de souveraineté nationale, de patrimoine commun de l’humanité et de responsabilité intergénérationnelle. La création d’un Conseil mondial des océans, réunissant États, organisations internationales, secteur privé, communauté scientifique et société civile, pourrait offrir un forum de coordination pour relever ce défi et assurer une exploitation véritablement durable des fonds marins au bénéfice des générations présentes et futures.
